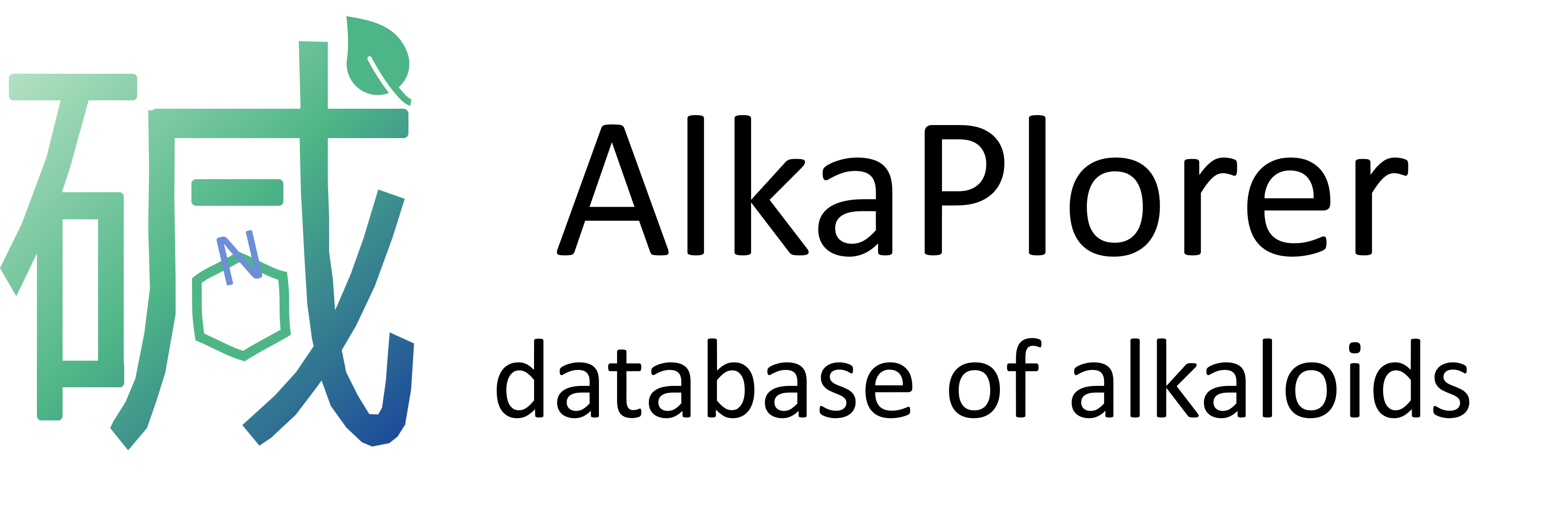
The structure of taxine B, the main alkaloid of leaves of European yew, Taxus baccata, has been revised by means of ¹H detected multiple bond heteronuclear multiple quantum coherence (HMBC) experiments. L'étude des alcaloïdes des feuilles de l'if d'Europe, Taxus baccata L. (Taxacées), est relativement ancienne. En effet, dès 1856, Lucas isole pour la première fois de l'if d'Europe, un alcaloïde mal défini appelé taxine (1). Graf, en 1956 (2), est le premier à reconnaître que la taxine est, en fait, un mélange d'alcaloïdes. Il isole plusieurs "taxines" dont trois sont partiellement identifiés: la taxine A, la taxine B, ainsi que la taxine C. Mais il faudra attendre 1986 pour que Graf et al. (3) établissent la structure de l'alcaloïde majoritaire des feuilles de l'if d'Europe, la taxine B (1). Celle-ci avait été étudiée parallèlement par Lythgoe (4) sous le nom de taxine I, décrite sous sa forme acétylée et désaminée, la triacétylcinnamoyltaxicine I (2). La taxine B (1) possède le squelette taxane (3) des composés trouvés dans les différentes espèces de Taxus (1) et des alcaloïdes décrits chez Austrotaxus spicata Compton (5,6). C'est à la suite de l'étude de ces derniers que nous avons été amenés à nous intéresser aux alcaloïdes de Taxus baccata dans la perspective d'y trouver une matière première abondante et facilement accessible qui nous permette de réaliser l'hémisynthèse projetée d'analogues du taxol (4), connu lui-même pour son activité antitumorale remarquable (7). L'extraction des alcaloïdes totaux des feuilles d'if par la même technique que celle utilisée pour les alcaloïdes d'A. spicata nous a permis de réisoler la taxine B (1). Ce composé, comme ont noté de nombreux auteurs dans le passé, est relativement instable du fait, principalement, de la présence d'un ester 3-diméthylamino-3-phénylpropionique qui se désamine assez facilement en dérivé cinnamoyle (1,3,4). Les données spectrales de la taxine B sont identiques à celles décrites par Graf et al. (3); mais, la position de l'unique acétate peut prêter à discussion. [On peut remarquer que les valeurs des constantes de couplage JH-H données par Graf et al. (3) et Weinandy (8) pour la taxine B sont systématiquement la moitié de celles mesurées dans ce travail.] En effet, ces auteurs (3) indiquent que le spectre ¹H-¹³C à longue distance (ou COLOC: "correlated spectroscopy via long range couplings") de la taxine B (1), ne montre pas de corrélation longue distance entre le carbonyle de l'acétate et l'un des protons en 2, 9 ou 10, corrélation qui aurait permis de placer l'acétate sans ambiguïté: ils proposent de placer l'acétate en position 2α du fait de l'absence de variation de déplacement chimique du C₁ entre 1 et la diacétyltaxine B (5). Pourtant, au vu des valeurs de RMN ¹H de la diacétyltaxine B (5) préparée par acétylation de 1 (Ac₂O/pyridine) et comparables à celles décrites par Graf et al. (8), on constate que le signal du H-2 résonne à 5.58 ppm pour 5 au lieu de 3.98 ppm pour 1. Graf et al. (3) et Weinandy (8) ne commentent pas cette variation importante de déplacement chimique (Δδ= 1.60 ppm); celle-ci pourrait s'expliquer si l'acétate est situé ailleurs qu'en C-2 où il y aurait alors un hydroxyle acétylable. Pour vérifier cette hypothèse, il a été réalisé sur la taxine B une expérience ¹H-¹³C à longue distance en détection inverse [ou ¹H detected multiple bond heteronuclear multiple quantum coherence (HMBC) (9)], plus sensible que le spectre COLOC: on peut noter sur ce spectre, une tache de corrélation correspondant à un couplage entre le carbonyle (δ MeC=O= 170.2 ppm) et le H-10 (5.85 ppm, d, J=9.5 Hz). Le tableau 1 indique les autres corrélations observées. Une dernière ambiguïté demeurait au niveau de l'attribution des δ des méthyles 16 et 17: une expérience d'E.O.N.-difference permet d'attribuer le signal résonnant à 1.52 ppm (3H, s) au Me-16, car on observe une réponse au niveau des protons H-2β et H-9β (Figure 1) et par soustraction le signal 1.25 ppm (3H, s) au méthyle en 17. Tous ces résultats nous amènent à proposer pour la taxine B, la nouvelle structure 6.